Trois pièces chorégraphiques de Benjamin Millepied, L.A. Dance Project, Le Balcon – musique Nico Muhly, direction Maxime Pascal et le collectif Le Balcon – orgue Alexis Grizard – à la Philharmonie de Paris-Cité de la Musique /La Villette.

Me.You.We.They.© Antoine Benoit-Godet
C’est une histoire d’amitié entre deux artistes qui se sont rencontrés en 2006 – Benjamin Millepied, chorégraphe, réalisateur et danseur, directeur de la compagnie L.A. Dance Project et Nico Muhly, compositeur – en même temps qu’un moment chorégraphique et musical intense. Ensemble, au fil de leurs parcours, ils ont notamment réalisé pour l’American Ballet en 2007, Theatre From Here On Out/À partir de maintenant ; pour l’Opéra de Paris en 2008, Triade ; pour le Dutch National Ballet en 2010, One Thing Leads to Another ; pour L.A. Dance Project en 2012, Moving Parts. Et ils ont fondé en 2022 avec Qatar Creates et Qatar Museums, un festival de danse international, Festival in Motion.
Benjamin Millepied et Nico Muhly présentent aujourd’hui dans la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris une nouvelle version de Triade et de Moving Parts, et ils signent ensemble une nouvelle création, Me.You.We.They. sous la direction musicale de Maxime Pascal et du collectif Le Balcon, qu’il a fondé.

Triade © Antoine Benoit-Godet
Triade, la première pièce du programme, fut créée en 2008, en hommage à Jérôme Robbins qui dirigea le New York City Ballet où Benjamin Millepied dansa, de 1995 à 2011, chorégraphe qui l’inspira. Écrite pour quatre danseurs, cette pièce fait alterner les sons cristallins de sonnailles aux variations de type asiatique – enregistrés sur une bande son – avec les mélodies des trombones, le décalé et les suspensions du piano. Tout est rythme. Un premier danseur vêtu de noir s’élance en solo et se déploie comme un gerfaut en plein vol, multipliant pirouettes et saltos avec beaucoup de grâce. Il est suivi d’un second danseur en débardeur rouge, dégageant une certaine puissance. Un dialogue s’engage entre eux avant que ne s’avance une danseuse vêtue d’une mousseline courte couleur brun-roux, formant un duo qui bientôt devient jeu à trois, portés de l’un à l’autre au son du piano qui monte de plus en plus et rythme la séquence. Une seconde danseuse, short et haut de dentelle, noirs, se fond dans la danse. Le danseur la regarde, une chorégraphie à quatre s’élabore, suivie d’une danse en duos. Légère comme une plume dans les portés et défiant les lois de la gravité, le duo vêtu de noir s’envole sur notes répétitives du piano solo. Puis vient un autre duo sur fond de jeux de la séduction, avant que tous dansent sur piano forte. Arrivent les trombones, entre énergie et ralentis, qui accompagnent les deux duos, interprétés de manière plus fantaisiste et acrobatique. Puis le dialogue avec le piano reprend et telle une sculpture, les danseuses retrouvent le sol. De toute beauté, cette pièce apporte une impression de fragilité-cristal.

Moving Parts © Antoine Benoit-Godet
La seconde pièce du programme, Moving Parts a été créée en 2012 pour six danseurs et se dessine à travers des praticables-murs qui roulent et voyagent à divers endroits du plateau formant différentes figures. Recouverts d’écritures, de lettres et de chiffres, de clés de sol type graffitis ces structures permettent construction – déconstruction, apparitions -disparitions (installation visuelle Christopher Wool). Elle débute par le solo d’un danseur, pantalon noir, gilet clair, qui vole et tourne avec vivacité au son de la clarinette sur lequel se greffent orgue et violon. Puis apparaît une danseuse portant une robe argentée et un danseur, ils dansent au sol en duo, sur une variation de musiques douces ; leurs gestes sont vifs. Suit un splendide solo pour orgue, on aperçoit le musicien placé très haut, face au public, dans cette grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris aménagée pour la danse. Un homme, un cri, un appel, le groupe est au sol et exécute un remarquable travail des bras similaire aux battements d’ailes. Puis s’enchaîne, sur un morceau de violon sans archet, un duo puissant interprété par deux danseurs, suivi d’un solo homme puis d’un solo femme sur clarinette, auxquels se joignent les autres danseurs sur la musique d’orgue, lancinante et créative. Alexis Grizard, organiste, se produit régulièrement en solo, avec ensemble de musique de chambre ou avec orchestre, il a participé entre autres en 2021 à l’enregistrement d’une intégrale de l’œuvre d’Olivier Messiaen à la cathédrale Saint-Étienne de Toul.

Me.You.We.They. © Antoine Benoit-Godet
Après un entracte, la seconde partie de la soirée donne à voir et à entendre en création mondiale Me.You.We.They. pièce pour dix danseurs et orchestre de chambre – ici le collectif Le Balcon dirigé par Maxime Pascal – construite sur la base d’un tempo uniforme et de figures musicales qui reviennent et se répètent, comme un ressac. « Tout est parti d’une conversation avec Benjamin Millepied alors que nous arpentions ensemble le désert du Qatar : nous imaginions la pulsation d’une note unique explosant ensuite en différentes variations » dit Nico Muhly le compositeur, qui souligne cette note avec un trio de vents et ajoute : « Un choral assez développé confié à deux vibraphones et un célesta accompagne la ligne soliste des vents. Suit une dernière section beaucoup plus épineuse qui explose en une conclusion à la joie presque menaçante. »

Me.You.We.They. © Antoine Benoit-Godet
Alignés au fond du plateau le long du rideau noir de scène, une dizaine de musiciens, noir sur noir, avec leurs instruments dont un grand tambour. Salutations des danseurs aux musiciens. Cela commence par des percussions cristallines sur un duo. Répartis de chaque côté du tapis de danse, de cour à jardin, les danseurs sont assis au sol, attendant le moment de leurs entrées et sorties. Trios et duos, pieds nus ou pas, sur flûtes et vents, légers, tour à tour, puis tous, précis et libres. Les costumes sont de couleur gris-vert foncé (costumes Camille Assaf pour les trois pièces). Entre dans le mouvement, en contrepoint, une danseuse, élégante jupe plissée sur envers jaune qui tourne de manière ludique sur des sons aigus, pépiements, flûtes et violons. Il y a quelque chose d’aquatique sur scène et des moments de suspension. Puis le tambour major ponctue la danse de deux femmes en duos, de manière vertigineuse, elles s’élèvent et virevoltent. Suit une montée musicale pour duo argenté, sur petites notes continues et un travail sur les cercles qui se font et se défont. Mouvement vif, marqué par les cloches. Tambour, accélération jusqu’à ce que l’un, puis tous, s’immobilisent. C’est à la fois riche et épuré, d’une grande beauté et correspondance entre la musique et le geste. La chorégraphie se fond dans la partition et le moment musical, et l’inverse, dans ce dialogue fécond entre deux artistes, Benjamin Millepied avec les danseurs du L.A. Dance Project et Nico Muhly avec la formation Le Balcon et son chef, Maxime Pascal qui entrent dans la danse. Il y a du monde sur le plateau.

Moving Parts © Antoine Benoit-Godet
Chorégraphe, réalisateur et danseur, Benjamin Millepied s’est formé au Conservatoire de Lyon avant de rejoindre la School of American Ballet de New York puis d’intégrer en 1995 le New York City Ballet dont il devient principal dancer en 2001 et où il interprète des ballets de George Balanchine et Jerome Robbins entre autres. Il a travaillé pour les plus grandes compagnies aux États-Unis et en Europe dont le San Francisco Ballet, le ballet de l’Opéra de Paris, le Mariinsky Ballet, le Staatsballett Berlin. Il a toujours collaboré avec d’autres artistes dont les compositeurs Nicholas Britell, David Lang, Bryce Dessner. En 2002 il fonde Danses Concertantes, un ensemble issu du New York City Ballet et c’est en 2012 qu’il cofonde la compagnie de danse, L.A. Dance Project, basée à Los Angeles. De 2014 à 2016 il prend la direction du ballet de l’Opéra de Paris et commande de nouvelles œuvres à de nombreux chorégraphes – William Forsythe, Justin Peck, Jérôme Bel, Wayne McGregor, Crystal Pite, Tino Seghal, Nico Muhly et James Blake. Côté cinéma Il signe la chorégraphie du film Black Swan de Darren Aronofsky en 2010, se trouve au cœur du documentaire Reset qui suit son travail au ballet de l’Opéra, en 2015, réalisee plusieurs courts métrages sur la danse. Carmen, son premier long-métrage, est sorti en France en 2023.
Compositeur américain, Nico Muhly est l’auteur d’œuvres orchestrales, de musique de chambre et de musique sacrée, il compose également pour la scène, et pour des bandes originales de films. Il collabore avec des artistes contemporains comme Maira Kalman et Oliver Beer, et avec des institutions comme la National Gallery de Londres et l’Art Institute de Chicago, pour lesquelles il a créé des pièces sur mesure. Son travail se nourrit de nombreuses collaborations, avec des chorégraphes comme Benjamin Millepied au ballet de l’Opéra de Paris, Bobbi Jene Smith à la Julliard School, Justin Peck et Kyle Abraham au New York City Ballet, des artistes musicaux comme Sufjan Stevens, The National, Teitur, Anohni, James Blake, Paul Simon. il est aussi cofondateur du label indépendant Bedroom Community, qui a édité ses deux premiers albums Speaks Volumes, en 2006 et Mothertongue, en 2008.

De g. à dte, Nico Muhly, Maxime Pascal, Benjamin Millepied, musiciens et danseurs © Antoine Benoit-Godet
A la direction d’orchestre, Maxime Pascal qui a fondé en 2008 le collectif Le Balcon, avec Florent Derex, ingénieur du son, Alphonse Cemin, pianiste et chef de chant et trois compositeurs : Juan Pablo Carreño, Mathieu Costecalde et Pedro García-Velásquez. Il explore un répertoire lyrique, symphonique et chambriste – avec une prédilection pour la période allant de 1945 à nos jours – en effectuant un travail ambitieux sur la spatialisation et la diffusion du son. Il est invité à diriger de nombreux orchestres en France – il a collaboré à plusieurs reprises avec l’Opéra national de Paris – en Europe, au Japon et en Amérique du Sud et défend aussi bien des créations lyriques de notre temps que des opéras du répertoire.
La conjugaison de leurs talents, la virtuosité en même temps que la liberté des danseurs de L.A. Dance Project interprétant les trois pièces du programme, de nature différente, sont un moment de grâce. La création, Me.You.We.They. apporte, dans sa simplicité et son amplitude, un certain magnétisme dont il est difficile de sortir en quittant la salle.
Brigitte Rémer, le 7 avril 2024

Danseurs du L.A. Dance Project © Antoine Benoit-Godet
Avec les danseurs, compagnie L.A. Dance Project : Courtney Conovan, Jeremy Coachman, Lorrin Brubaker, Daphne Fernberger, David Adrian Freeland Jr, Eva Galmel (danseuse invitée), Shu Kinouchi, Audrey Sides, Hope Spears, Nayomi Van Brunt – direction de la production, Nathan Shreeve-Moon – régie, Betsy Herst – création lumière associée Venus Gulbranson – création costumes associée Aliénor Figueiredo – organisation des tournées Alisa Wyman. Direction artistique, Benjamin Millepied – direction exécutive, Lucinda Lent – Benjamin Millepied, chorégraphie – Nico Muhly, musique – Le Balcon, Maxime Pascal, direction d’orchestre – Alexis Grizard, orgue – coréalisation La Villette, Philharmonie de Paris – coproduction L.A. Dance Project, Philharmonie de Paris – avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet, Grande Mécène Fondatrice de Musique en Scène.

Collectif Le Balcon, musiciens – et danseurs
Triade, tribute to Jerome Robbins, pour 4 danseurs – chorégraphie Benjamin Millepied – musique Nico Muhly, avec l’aimable autorisation de Première Music Group – costumes Camille Assaf – création lumière Masha Tsimring – création le 20 septembre 2008, à l’Opéra Garnier, Paris – Maxime Delattre, trombone – Sébastien Gonthier, trombone basse – Alphonse Cemin, piano (21 minutes environ) – Moving Parts, pour 6 danseurs – commande Glorya Kaufman Presents Dance at the Music Center, Los Angeles (CA) – chorégraphie Benjamin Millepied – musique Nico Muhly, avec l’aimable autorisation de Première Music Group – costumes Camille Assaf – création lumière Masha Tsimring – installation visuelle Christopher Wool – création le 22 septembre 2012, au Walt Disney Concert Hall de Los Angeles (CA) – musiciens Hélène Maréchaux, violon – Iris Zerdoud, clarinette – Alexis Grizard, orgue, (25 minutes environ) – Me.You.We.They, pour 10 danseurs – chorégraphie Benjamin Millepied, en collaboration avec les danseurs de L.A. Dance Project – musique : One Speed, Many Shapes de Nico Muhly, avec l’aimable autorisation de Première Music Group – costumes Camille Assaf – création lumière : Masha Tsimring – création le 29 mars 2024, à la Philharmonie de Paris – musiciens : Hélène Maréchaux, violon – Laura Vaquer, violon – Elsa Seger, alto – Askar Ishangaliyev, violoncelle – Héloïse Dély, contrebasse – Claire Luquiens, flûte – Quentin d’Haussy, hautbois – Ghislain Roffat, clarinette – Julien Abbes, basson – Joël Lasry, cor – Henri Deléger, trompette – Maxime Delattre, trombone – François-Xavier Plancqueel, percussions – Akino Kamiya, percussions – Alphonse Cemin, piano, (23 minutes environ).
Vendredi 29 et samedi 30 mars 2024, à 20h, dimanche 31 mars à 16h et 19h, à la Philharmonie de Paris-Cité de la Musique/La Villette, 221 avenue Jean-Jaurès. 75019. Paris – métro : Porte de Pantin – tél. : +33 (0)1 44 84 44 84 – site : philharmoniedeparis.fr.


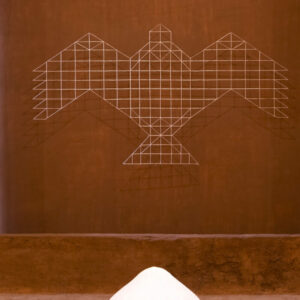






































Vous devez être connecté pour poster un commentaire.